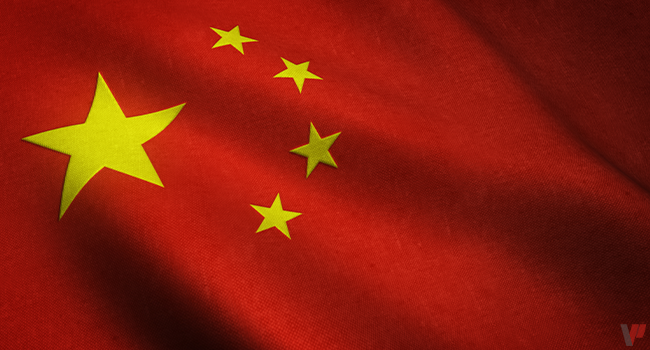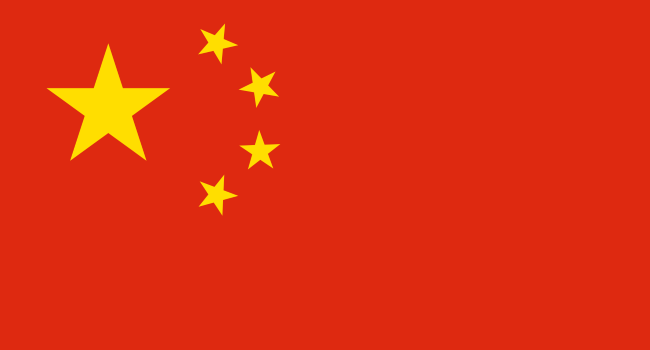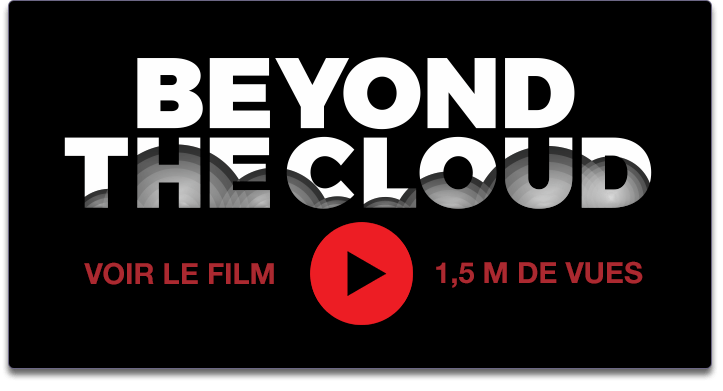La cigarette électronique en Chine
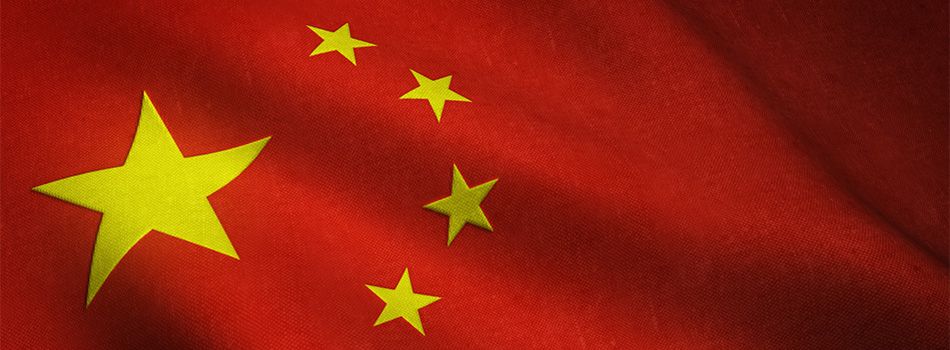
Fabriquer, oui, mais utiliser, non
Véritable usine pour le monde entier, la Chine est le pays où est fabriquée l’immense majorité des cigarettes électroniques utilisées à travers le monde.
Un fait qui n’empêche pas le pays d’en compliquer l’accès à ses propres citoyens.
Fabriquer, oui, utiliser, non
Économiquement parlant, la situation économique de la Chine, concernant le tabac, est assez particulière puisque l’industrie est sous monopole d’état.
Au début de l’année 2022, le secteur de la cigarette électronique a lui aussi été accaparé par le gouvernement. Outre la mise en place de nombreuses règles très strictes concernant la vente des produits du vapotage, le gouvernement a également fait le choix d’interdire les e-liquides aromatisés à autre chose qu’au tabac.
Les systèmes dits « fermés », c’est-à-dire les pods, sont également proscrits. De quoi largement limiter la possibilité de la cigarette électronique de se montrer efficace pour le sevrage tabagique. La population devrait ainsi continuer de fumer, et l’État, d’encaisser.
Les principales actualités en Chine
Les dernières nouvelles en Chine
Consultez ci-dessous l’ensemble de nos articles qui parlent de de la Chine.
La Chine : premier producteur et consommateur mondial de tabac
La Chine détient le triste record d’être à la fois le premier producteur et le premier consommateur de tabac au monde. Avec environ 300 millions de fumeurs, le pays représente près d’un tiers des fumeurs de la planète et absorbe 99% de sa production nationale de tabac. Cette situation fait de l’Empire du Milieu un cas unique dans le paysage mondial du tabagisme, où les enjeux sanitaires s’entremêlent avec des considérations économiques et culturelles profondément ancrées.
Le taux de tabagisme chez les adultes chinois, bien qu’en baisse progressive, demeure significativement élevé. Selon les statistiques officielles, il est passé de 26,6% en 2018 à 24,1% en 2022, un niveau qui reste supérieur à la moyenne mondiale d’environ 17% en 2021. La Chine s’est fixée pour objectif de réduire la prévalence du tabagisme chez les adultes à 20% d’ici 2030, mais l’atteinte de cet objectif représente un défi considérable au vu de la place qu’occupe le tabac dans la société et l’économie chinoises.
Une disparité de genre marquée
L’un des aspects les plus frappants du tabagisme chinois réside dans l’écart considérable entre hommes et femmes. Au début d’études récentes menées entre 2004 et 2008, 74,3% des hommes étaient fumeurs, contre seulement 3,2% des femmes. Cette disparité, bien qu’elle tende à se réduire légèrement avec l’entrée des nouvelles générations de femmes dans le tabagisme, reste l’une des plus importantes au monde.
Paradoxalement, cette faible prévalence du tabagisme chez les femmes de la génération née en 1960, où seul 1% d’entre elles fumaient, contraste avec les 10% observés chez les femmes nées en 1930. Cette évolution atypique s’explique par les changements sociaux et culturels survenus en Chine au cours du XXe siècle. Toutefois, les experts craignent un rebond du tabagisme féminin dans les jeunes générations, attirées par des produits du tabac plus élégants et par l’évolution des normes sociales.
Un fardeau sanitaire considérable
Les conséquences sanitaires du tabagisme en Chine sont dévastatrices. Les études révèlent que les fumeurs chinois présentent des risques significativement plus élevés de développer 56 maladies différentes par rapport aux non-fumeurs, dont 50 pour les hommes et 24 pour les femmes. La tranche d’âge des 40-79 ans, particulièrement touchée par le tabagisme, subit également la mortalité prématurée la plus élevée liée à la consommation de tabac.
Les projections sont alarmantes : sans action rapide et déterminée pour réduire les niveaux de tabagisme, la Chine pourrait faire face à près de 2 millions de décès annuels liés au tabac d’ici 2030. Actuellement, une personne décède des suites du tabagisme toutes les 30 secondes dans le pays. Le cancer du poumon représente l’une des principales causes de cette mortalité, et la pollution atmosphérique, déjà identifiée comme le deuxième facteur de risque de cancer du poumon après le tabac, aggrave encore la situation, représentant plus de 25% du taux de mortalité de ce cancer en Chine.
Le monopole d’État : entre contrôle économique et enjeux sanitaires
La particularité chinoise réside dans le fait que l’industrie du tabac est entièrement contrôlée par l’État depuis 1980. La State Tobacco Monopoly Administration gère la réglementation du marché, tandis que la China National Tobacco Corporation, société publique, détient 98% des parts de marché sur le territoire national. Cette corporation est le premier fabricant de cigarettes au monde, devant même l’Indonésie, et emploie plus de 500 000 personnes.
Le secteur du tabac revêt une importance économique capitale pour la Chine : la CNTC est le premier contribuable du pays en termes de taxes, loin devant le premier opérateur bancaire. Travailler dans cette industrie est considéré comme prestigieux, notamment en raison des salaires très attractifs proposés. Cette valorisation économique et sociale du secteur crée une tension fondamentale avec les objectifs de santé publique.
Des politiques de lutte antitabac entravées
Bien que la Chine ait signé et ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac en 2005, les progrès en matière de réduction du tabagisme restent lents comparativement à d’autres pays. L’absence de réglementation nationale cohérente sur le tabagisme constitue un obstacle majeur. En novembre 2014, le Conseil d’État avait élaboré un projet national de lutte contre le tabagisme pour remplir les obligations du pays vis-à-vis de la convention internationale, mais ce projet est resté bloqué dans son processus de validation.
Les facteurs culturels jouent également un rôle important dans la persistance du tabagisme. Apparu dans les années 1930 et s’étant répandu massivement après 1949 avec l’instauration de la République Populaire, le tabagisme a été fortement valorisé dans l’iconographie officielle, avec des dirigeants historiques comme Mao Zedong, Zhou Enlai et Deng Xiaoping régulièrement photographiés cigarette à la main. Cette normalisation sociale du tabac demeure profondément ancrée dans la culture chinoise.
De plus, plusieurs idées reçues limitent l’efficacité des messages de prévention. Certains croient notamment que des mécanismes biologiques propres à la population asiatique rendraient le tabagisme moins dangereux, qu’il serait plus facile d’arrêter de fumer pour les Asiatiques, ou encore que la consommation de tabac serait intrinsèquement liée à la culture chinoise ancestrale.
La cigarette électronique sous le joug du monopole d’État
Paradoxalement, alors que la Chine est le principal fabricant mondial de cigarettes électroniques, produisant la quasi-totalité du matériel de vapotage vendu dans le monde, l’usage de ces dispositifs reste très peu répandu sur le territoire national. Cette situation singulière s’explique par une série de mesures réglementaires de plus en plus restrictives mises en place au cours des dernières années.
Une réglementation progressive mais drastique
Le tournant décisif s’est opéré en 2018, lorsque l’Administration nationale du monopole du tabac et l’Administration nationale de la réglementation du marché ont publié une circulaire restreignant l’accès des mineurs aux produits de vapotage. L’année suivante, en 2019, les autorités ont durci cette réglementation en interdisant toute vente en ligne de cigarettes électroniques ainsi que leur publicité sur l’ensemble du territoire.
En mars 2021, une nouvelle étape a été franchie avec l’annonce du passage du marché de la cigarette électronique sous monopole d’État, confiant ainsi à la STMA, l’organisme qui gère déjà le monopole du tabac, la régulation complète de l’industrie de la vape. Cette décision a soulevé de nombreuses interrogations quant à la légitimité d’un organisme spécialisé dans les produits du tabac à réglementer les alternatives au tabac, et sur les intentions réelles derrière cette mainmise gouvernementale.
L’interdiction des arômes et autres restrictions majeures
Le 1er octobre 2022 marque l’entrée en vigueur d’une réglementation parmi les plus restrictives au monde concernant la cigarette électronique. Depuis cette date, tous les arômes autres que le tabac sont formellement interdits dans les e-liquides commercialisés en Chine. Cette mesure a provoqué une ruée des vapoteurs chinois vers leurs produits aromatisés préférés avant leur disparition définitive du marché.
Mais l’interdiction des arômes n’est que la partie visible d’une réglementation beaucoup plus contraignante. Seuls les systèmes fermés, c’est-à-dire les pods avec cartouches scellées et non rechargeables, sont désormais autorisés à la vente. Les cigarettes électroniques à système ouvert ont été totalement bannies du marché chinois. De plus, la nicotine doit obligatoirement être dérivée du tabac, la nicotine synthétique étant formellement interdite. La pureté de la nicotine ne doit pas être inférieure à 99%, et la concentration maximale est limitée à 20 milligrammes par millilitre, conformément aux standards européens.
Un système de licences très restrictif
Pour pouvoir exercer leur activité, tous les fabricants et vendeurs chinois doivent désormais posséder une licence de production et de vente délivrée par la STMA. Ce système de licences s’est révélé particulièrement sélectif : alors que l’industrie de la vape chinoise regroupait environ 170 000 entreprises en combinant fabrication et vente, seuls 190 fabricants et 55 000 détaillants avaient obtenu cette précieuse licence en août 2022, témoignant d’un effondrement du secteur sur le marché intérieur.
Les entreprises étrangères ne peuvent vendre leurs dispositifs que si elles possèdent une licence spécifique, et tous les produits importés ne peuvent être commercialisés que via une plateforme de transaction dédiée aux cigarettes électroniques. Ces produits doivent également subir un examen technique approfondi et utiliser une marque enregistrée en Chine.
La taxation des produits du vapotage devrait passer de 13% actuellement à 67%, un taux identique à celui appliqué aux produits du tabac. Cette harmonisation fiscale renforce encore davantage l’assimilation des produits de vapotage aux produits du tabac traditionnel.
Des restrictions géographiques variables
Les règles concernant l’usage de la cigarette électronique varient selon les régions chinoises. Dans certaines grandes villes comme Shanghai et Shenzhen, vapoter dans les espaces publics est strictement interdit, avec des amendes pouvant atteindre 100 000 yuans chinois, soit environ 14 000 euros. Cette sévérité des sanctions contraste avec la relative tolérance observée dans d’autres régions du pays.
Un impact économique majeur et des questions sur l’avenir
En 2021, le marché chinois de la cigarette électronique était estimé à 8,38 milliards de yuans, soit 1,15 milliard d’euros. Entre 2013 et 2020, ce marché avait connu une croissance annuelle de plus de 70%, représentant près de 5% des revenus fiscaux du pays. Le secteur avait créé 3 millions d’emplois pour les 170 000 entreprises actives dans la vente et la fabrication.
Cette réglementation drastique soulève de nombreuses interrogations. Avec une offre désormais limitée aux seuls e-liquides au goût tabac et aux systèmes fermés, les millions de vapoteurs chinois qui avaient entamé leur sevrage tabagique grâce à la cigarette électronique ne risquent-ils pas de revenir vers la cigarette traditionnelle ? Certains observateurs évoquent déjà l’émergence d’un marché noir, des commerçants ayant stocké en grande quantité des produits spécifiques pour continuer à satisfaire la demande de leurs clients malgré l’interdiction.
Il est important de noter que ces restrictions ne s’appliquent qu’aux produits destinés au marché intérieur chinois. Les produits fabriqués pour l’exportation ne sont pas concernés par ces normes, ce qui permet aux fabricants du monde entier de continuer à produire en Chine. Toutefois, pour les pays n’ayant pas de réglementation spécifique sur la cigarette électronique, c’est la norme chinoise qui s’imposera par défaut.
Une approche contestée par les défenseurs de la réduction des risques
La décision de placer l’industrie de la cigarette électronique sous le contrôle de la STMA, qui partage ses locaux avec la China National Tobacco Corporation, premier fabricant de cigarettes au monde, a suscité de vives critiques. Comment un organisme peut-il gérer équitablement la législation de la vape alors que son domaine principal reste les produits du tabac ? Cette question de conflit d’intérêts est d’autant plus pertinente que le marché du tabac représente 11% des recettes publiques chinoises.
Certains analystes y voient une volonté de protéger le marché intérieur des cigarettes traditionnelles plutôt qu’une véritable politique de santé publique. D’autres estiment cependant que le fait d’incorporer le vapotage dans le cadre législatif de l’industrie du tabac donne à ce secteur un espace juridique légitime dans lequel exister, et que cela pourrait signaler une reconnaissance par le gouvernement chinois de la cigarette électronique comme outil potentiel de réduction des risques et de sevrage tabagique.
Face à un taux de tabagisme qui reste parmi les plus élevés au monde et à des projections sanitaires alarmantes, la Chine se trouve à un carrefour décisif. L’avenir dira si l’approche restrictive adoptée envers la cigarette électronique servira réellement les objectifs de santé publique, ou si elle contribuera paradoxalement à maintenir les fumeurs dans leur consommation de tabac traditionnel, plus nocif pour la santé.
Sources et références
- La vente de tabac en augmentation en Chine – Chine Info
- En Chine, l’industrie du tabac et les habitudes sociales freinent la réduction du tabagisme – Générations sans tabac
- Tabac : 2 millions de morts en Chine en 2030 – Fréquence Médicale
- Le tabagisme recule malgré les efforts déployés par l’industrie du tabac – OMS
- La Chine resserre le contrôle du marché des cigarettes électroniques – Générations sans tabac