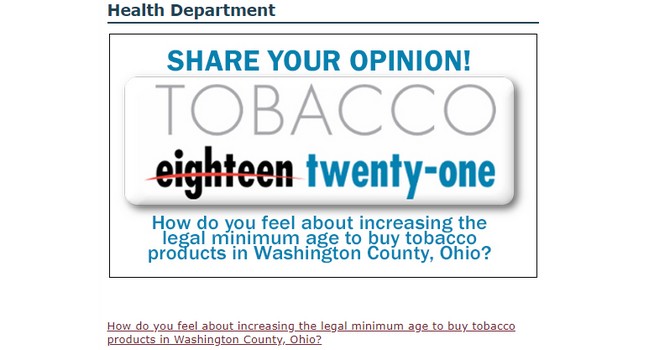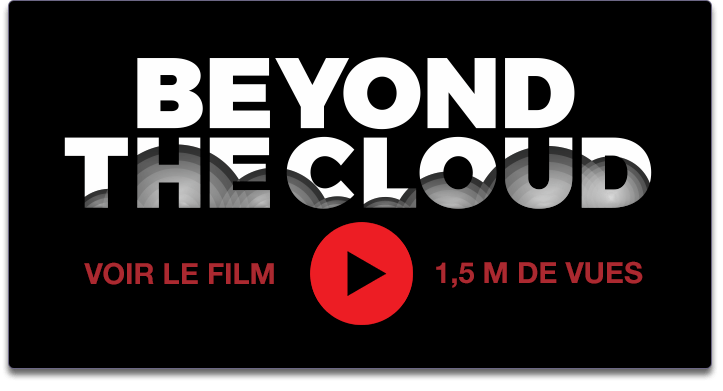La cigarette électronique aux États-Unis
États-Unis : une réussite historique dans la lutte contre le tabagisme
Les États-Unis représentent l’une des plus belles réussites mondiales en matière de lutte contre le tabagisme. En 1944, lors de la première enquête Gallup sur le sujet, 41% des adultes américains déclaraient fumer. Ce taux a même culminé à 45% en 1954 avant de commencer à décliner progressivement. En 2024, seulement 11% des adultes américains ont déclaré avoir fumé des cigarettes au cours de la semaine écoulée, soit le taux historiquement le plus bas jamais enregistré dans le pays.
Cette baisse spectaculaire de plus de 73% depuis 1965 représente une victoire majeure de santé publique. Chez les jeunes adultes de moins de 30 ans, les chiffres sont encore plus impressionnants : seuls 6% déclaraient fumer en 2024, contre 35% au début des années 2000. Cependant, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable aux États-Unis, causant encore environ 490 000 décès par an.
L’émergence de Juul : de l’innovation à la controverse
L’histoire du vapotage aux États-Unis est indissociable de celle de Juul Labs, une entreprise qui a profondément marqué le marché américain. Créée en 2015 par deux étudiants, la start-up a lancé un pod compact aux allures de clé USB qui s’est rapidement imposé comme la référence des cigarettes électroniques outre-Atlantique. En seulement deux ans, Juul possédait 70% des parts du marché de la vape américain, attirant même l’attention du géant du tabac Altria (Philip Morris aux États-Unis) qui a investi plusieurs milliards de dollars dans l’entreprise en 2018.
Le succès fulgurant de Juul s’expliquait notamment par son design discret, ses arômes variés et son système de pods préremplis facile d’utilisation. Toutefois, cette popularité s’est rapidement transformée en cauchemar lorsque la Food and Drug Administration (FDA) a commencé à s’intéresser de près à la société en 2019. Accusée de cibler les jeunes avec ses saveurs fruitées et sa communication jugée inadaptée, Juul est devenue le bouc émissaire idéal d’une prétendue “épidémie de vapotage chez les mineurs”.
Face à la pression, Juul a progressivement retiré la plupart de ses arômes et cessé toute publicité. En 2022, la FDA a émis une ordonnance interdisant la commercialisation de tous les produits Juul aux États-Unis. Deux ans plus tard, en juin 2024, l’agence a annulé cette ordonnance et accepté de rouvrir le dossier. En 2025, Juul a finalement obtenu l’autorisation de revenir sur le marché américain avec ses pods au tabac et au menthol, mais cette décision reste vivement contestée par certains sénateurs démocrates qui dénoncent des conflits d’intérêts au sein de l’administration Trump.
La crise EVALI : une hystérie médiatique sans précédent
En août 2019, une vague de pneumopathies sévères a frappé les États-Unis, semant la panique dans tout le pays. Des centaines de personnes ont été hospitalisées pour de graves infections respiratoires, et plusieurs sont décédées. Rapidement, les autorités sanitaires ont désigné un coupable : la cigarette électronique. Les médias se sont emparés de l’affaire avec des titres alarmistes, et en quelques jours, le vapotage était présenté comme un tueur en puissance.
Pourtant, dès le début, plusieurs éléments auraient dû alerter sur l’origine réelle du problème. Premièrement, ces cas n’apparaissaient qu’aux États-Unis, alors que la cigarette électronique était utilisée depuis des années en Europe et ailleurs dans le monde sans incidents similaires. Deuxièmement, de nombreux malades ont rapidement admis avoir consommé des produits au THC (la molécule active du cannabis) achetés sur le marché noir, non des e-liquides nicotinés traditionnels.
En novembre 2019, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont finalement identifié le véritable coupable : l’acétate de vitamine E, un agent huileux utilisé par des dealers pour diluer et épaissir des cartouches de THC vendues illégalement. Cette substance, sans danger lorsqu’elle est ingérée ou appliquée sur la peau, devient extrêmement dangereuse lorsqu’elle est inhalée, créant une couche graisseuse dans les poumons et provoquant de graves inflammations.
L’acétate de vitamine E a été retrouvé dans 94% des échantillons de fluide pulmonaire des patients atteints. En revanche, il n’a été détecté dans aucun des échantillons prélevés sur des vapoteurs en bonne santé utilisant des e-liquides nicotinés classiques. La crise EVALI (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury) n’avait donc strictement rien à voir avec le vapotage traditionnel, mais tout à voir avec la consommation de produits frelatés au cannabis sur le marché noir.
Le mal était néanmoins fait. Pendant des mois, les autorités sanitaires et les médias ont continué d’incriminer la cigarette électronique de manière générale, créant une confusion dangereuse dans l’esprit du public. En février 2020, 66% des Américains interrogés croyaient encore que les décès étaient liés au vapotage nicotiné, alors que seuls 28% savaient que les produits au THC du marché noir étaient en cause. Cette désinformation a eu des conséquences dramatiques : des millions de vapoteurs sont retournés à la cigarette, et des dizaines de millions de fumeurs ont été dissuadés d’essayer le vapotage comme outil de sevrage.
Le vapotage chez les jeunes : une “épidémie” largement exagérée
L’un des arguments les plus fréquemment brandis contre la cigarette électronique aux États-Unis concerne le vapotage chez les adolescents. En 2019, au pic de ce qui a été qualifié d'”épidémie”, 27,5% des lycéens déclaraient avoir vapoté au moins une fois au cours des 30 derniers jours. Ces chiffres ont immédiatement déclenché une panique morale et servi de justification pour des réglementations drastiques.
Cependant, un regard plus nuancé sur les données permet de relativiser considérablement cette prétendue épidémie. Premièrement, même à son apogée en 2019, plus de 70% des lycéens n’avaient jamais essayé la cigarette électronique. Deuxièmement, l’utilisation régulière ou intensive restait l’apanage d’une minorité : seuls 27,6% des lycéens vapoteurs utilisaient leur dispositif quotidiennement.
Plus révélateur encore, les chiffres ont rapidement chuté dans les années suivantes, sans qu’aucune mesure particulièrement restrictive n’ait été mise en place au préalable. En 2021, le taux de vapotage chez les lycéens était tombé à 11,3%, soit une baisse de 59% en seulement deux ans. En 2023, ce taux n’était plus que de 10%, et en 2024, il avait encore diminué pour atteindre environ 8% – soit une diminution de 63,6% depuis 2019.
Chez les collégiens, les résultats sont encore plus spectaculaires. Le taux de vapotage est passé de 10,5% en 2019 à seulement 4,6% en 2023, soit une baisse de 56,2%. Dans l’ensemble, le vapotage chez les collégiens et lycéens a diminué de 61,5% depuis son pic de 2019, passant de 20% à 7,7% en 2023.
Ces données suggèrent que le prétendu “fléau” du vapotage adolescent ressemblait davantage à une mode passagère – certes dérangeante pour les parents et les enseignants, mais pas fondamentalement différente d’autres engouements éphémères de la jeunesse. Rétrospectivement, il apparaît que la panique morale autour du vapotage des jeunes a été largement disproportionnée par rapport à la réalité du phénomène.
Le tabagisme chez les jeunes : un succès historique
Ce qui est souvent passé sous silence dans les débats sur le vapotage des adolescents, c’est l’effondrement parallèle du tabagisme dans cette même population. En 2024, seulement 1,4% des lycéens américains déclaraient fumer des cigarettes – un record historique absolu. Le taux de tabagisme chez l’ensemble des jeunes (collégiens et lycéens) n’était plus que de 1,6%, un niveau qui est resté inférieur à 2% pendant trois années consécutives.
Cette disparition quasi totale de la cigarette chez les jeunes Américains représente une victoire sanitaire majeure. À titre de comparaison, au début des années 2000, 35% des jeunes adultes de moins de 30 ans fumaient. La cigarette a pratiquement disparu des écoles américaines, un exploit inimaginable il y a encore deux décennies.
De nombreux observateurs établissent un lien entre cette chute du tabagisme et l’émergence du vapotage. Alors que les associations antitabac s’inquiétaient d’un prétendu “effet passerelle” qui conduirait les jeunes vapoteurs vers la cigarette, la réalité a montré exactement l’inverse : une génération entière s’est détournée du tabac au profit d’alternatives moins nocives, avant finalement de réduire également leur consommation de cigarettes électroniques.
Des politiques prohibitionnistes contre-productives
Face à la prétendue épidémie de vapotage chez les jeunes, plusieurs États américains ont adopté des mesures prohibitionnistes, notamment l’interdiction des arômes dans les e-liquides. L’argument avancé était que ces saveurs fruitées ou sucrées attireraient spécifiquement les mineurs vers le vapotage.
Pourtant, les données scientifiques démontrent que ces interdictions ont eu des effets pervers majeurs. Une étude de l’Université de Yale publiée en décembre 2024 a révélé que dans les États ayant interdit les arômes, la baisse du vapotage s’est systématiquement accompagnée d’une hausse marquée du tabagisme dans la même population. Les chercheurs ont constaté que les politiques restreignant les ventes d’arômes affectaient négativement les pratiques de vapotage tout en augmentant paradoxalement le tabagisme chez les jeunes adultes.
En d’autres termes, en privant les fumeurs adultes d’arômes qui les aidaient à rester loin de la cigarette, ces politiques ont renvoyé de nombreux vapoteurs vers le tabac – exactement l’inverse de l’objectif recherché. Une enquête de l’Université de l’État de l’Ohio a d’ailleurs montré que 71% des jeunes vapoteurs déclaraient qu’ils arrêteraient de vapoter si tous les arômes étaient interdits. Malheureusement, l’étude ne précisait pas combien retourneraient à la cigarette.
Un paradoxe américain
Les États-Unis présentent aujourd’hui un paradoxe troublant en matière de politique de santé publique. D’un côté, le pays a réussi une remarquable réduction du tabagisme, atteignant des taux historiquement bas qui font l’envie du monde entier. De l’autre, la FDA et les autorités sanitaires mènent une véritable guerre contre la cigarette électronique, refusant d’autoriser la quasi-totalité des produits aromatisés et créant un environnement réglementaire extrêmement hostile à la réduction des risques.
À ce jour, seuls 23 produits du vapotage ont reçu l’aval de la FDA, et il s’agit uniquement de dispositifs au goût tabac. Les demandes d’autorisation de saveurs au menthol et à la menthe sont systématiquement rejetées, malgré leur importance pour les fumeurs adultes en sevrage. Cette politique s’explique en grande partie par l’hystérie médiatique autour de la crise EVALI et par l’obsession de “protéger les jeunes” contre le vapotage, même si les chiffres montrent que cette préoccupation est largement exagérée.
La situation est d’autant plus ironique que, pendant la crise EVALI, l’administration Trump avait annoncé vouloir interdire tous les arômes de cigarettes électroniques. Pourtant, cette même administration tolère la vente libre d’armes de guerre et n’a jamais envisagé d’interdire les cigarettes traditionnelles, qui tuent chaque année près d’un demi-million d’Américains. Ce double standard illustre à quel point les politiques de santé publique peuvent être influencées par des paniques morales déconnectées des réalités scientifiques.
Des leçons à tirer
L’expérience américaine offre plusieurs enseignements précieux pour les autres pays. Premièrement, elle démontre qu’une hystérie médiatique mal informée peut avoir des conséquences sanitaires désastreuses, en détournant les fumeurs d’outils de sevrage efficaces. Deuxièmement, elle montre que les politiques prohibitionnistes visant à “protéger les jeunes” peuvent paradoxalement les exposer à des risques plus grands en les poussant vers le tabac.
Troisièmement, et peut-être plus important encore, les données américaines suggèrent que le vapotage chez les adolescents, bien que préoccupant, relève davantage de la mode passagère que de l’épidémie sanitaire. Les chiffres ont chuté drastiquement sans mesures draconiennes, suivant probablement leur cours naturel comme toute tendance juvénile.
Enfin, le cas américain illustre la nécessité d’une communication claire et honnête de la part des autorités sanitaires. En entretenant la confusion entre vapotage nicotiné et cartouches de THC frelatées pendant la crise EVALI, le CDC et la FDA ont gravement nui à la santé publique, dissuadant des millions de fumeurs d’essayer une méthode de sevrage plus sûre que la cigarette.
Pour les vapoteurs envisageant un voyage aux États-Unis, il est important de noter que, contrairement à des pays comme la Thaïlande, le vapotage y reste légal. Cependant, la disponibilité des produits peut varier considérablement d’un État à l’autre, certains ayant adopté des réglementations beaucoup plus restrictives que d’autres. Les arômes autres que le tabac peuvent être difficiles à trouver dans certaines juridictions, et il est recommandé de se renseigner sur les lois locales avant de voyager.
Sources
- Génération sans tabac – États-Unis : 11% des adultes sont fumeurs, un taux historiquement bas
- Génération sans tabac – États-Unis : Importantes disparités dans les taux de tabagisme selon les catégories de la population
- Le Monde du Tabac – États-Unis : jamais le taux des fumeurs n’a été si bas
- Voyage aux USA – Prix des cigarettes aux États-Unis : tendances et variations en 2025
- Euronews – Les e-cigarettes Juul interdites aux États-Unis, vers un même destin en Europe ?
- Génération sans tabac – États-Unis : la Cour suprême confirme la décision de la FDA d’interdire les produits de vapotage aromatisés
- Génération sans tabac – Etats-Unis : La FDA annule son interdiction de mise sur le marché des produits JUUL
- La Presse – États-Unis: interdiction partielle des cigarettes électroniques aromatisées
- Génération sans tabac – États-Unis : le vapotage diminue chez les adolescents
- Issues.fr – La baisse du vapotage fait chuter la consommation de produits du tabac chez les jeunes américains à un niveau record
- Addict Aide – L’épidémie d’EVALI et ses conséquences sur les ventes de tabac aux USA
- Sovape – Retour sur la vague de pneumopathies de 2019 aux USA – EVALI