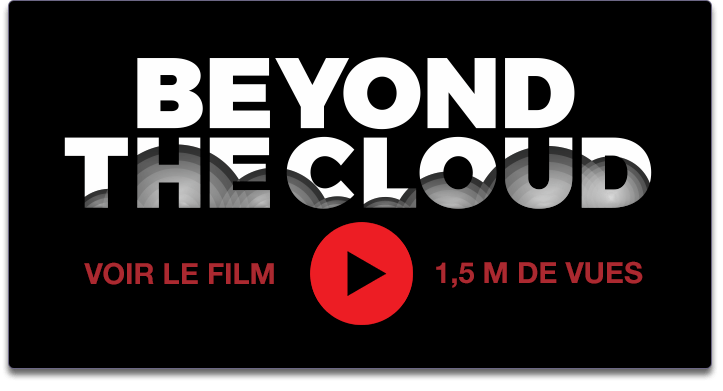Malgré une évolution de ton, l’Organisation mondiale de la santé maintient sa position intransigeante contre la cigarette électronique dans son rapport de 2025, au mépris des dernières avancées scientifiques sur la réduction des risques et l’arrêt du tabac.
En bref
- Dans son dernier rapport, l’OMS continue de critiquer le vapotage.
- L’organisation indique qu’il conduit au tabagisme, malgré les nombreuses données scientifiques qui semblent démontrer le contraire.
- Elle a toutefois l’air de modérer son discours concernant les méfaits de la cigarette électronique sur la santé.
L’OMS persiste et signe : la guerre contre la vape continue

La position de l’OMS sur le vapotage reste difficilement défendable.
Du 23 au 25 juin dernier, se déroulait à Dublin (Irlande), le vingtième anniversaire de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). L’occasion pour l’Organisation mondiale de la santé de présenter son dernier rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme1 (WHO report on the global tobacco epidemic, 2025), et de critiquer le vapotage.
Dans la partie qui lui était consacrée (p.104-112), le ton est donné dès la première ligne : l’OMS « invite les Parties à envisager l’application de mesures réglementaires (…) afin d’interdire ou de restreindre la fabrication, l’importation, la distribution, la présentation, la vente et l’utilisation des cigarettes électroniques. »
Suite du sous-titre, « les cigarettes électroniques sont addictives et nocives », l’Organisation explique que les e-liquides utilisés dans les vaporisateurs personnels « contiennent de la nicotine ainsi que divers additifs, arômes et produits chimiques, dont certains sont toxiques pour la santé. » Aucune précision supplémentaire n’est donnée concernant les composés en question. Cette section n’a d’ailleurs droit à aucune référence scientifique. Voilà qui explique, peut-être, pourquoi l’OMS ne s’attarde pas sur le sujet et cible ensuite, très rapidement, la nicotine, qui est qualifiée de « hautement addictive (…) en particulier chez les enfants et les adolescents. »
Des arguments fragiles et peu de preuves
Le vapotage des mineurs est donc immédiatement mis en avant, dès les premières lignes, malgré de nombreuses données de terrain qui démontrent que, non seulement, les jeunes ne seraient pas si nombreux à vapoter, mais, en plus, que la cigarette électronique jouerait un rôle de détournement du tabagisme2. Autrement dit, les enfants qui vapotent ne fument pas, et consomment un produit dont les effets néfastes sur leur santé sont moindres que ceux du tabagisme. Des données que l’OMS possède puisque ses propres rapports le démontrent, mais qui ne l’empêchent pas de conclure que « l’utilisation de cigarettes électroniques augmente l’initiation à la cigarette conventionnelle, surtout chez les jeunes non-fumeurs. » L’éternelle théorie de la passerelle, cette fois justifiée par une étude3.
Que dit l’étude citée par l’OMS ?
Une fois n’est pas coutume, après avoir longtemps cité l’étude du chercheur américain, Stanton Glantz, malgré sa rétractation, l’Organisation mondiale de la santé a, cette fois-ci, mentionné une étude à la méthodologie robuste.;
Cette méta-analyse s’est penchée sur l’association entre l’utilisation du vaporisateur personnel chez des jeunes qui n’avaient jamais fumé, et le risque qu’ils deviennent fumeurs par la suite. Autrement dit, la question de savoir si le vapotage conduit au tabagisme.
Malgré des forces méthodologiques indéniables (25 études incluses, application de nombreux critères d’inclusion et d’exclusion, avec double évaluation indépendante par deux chercheurs, etc.), cette recherche possède de nombreuses limites, que l’OMS n’a, semble-t-il, pas souhaité souligner, et encore moins prendre en compte :
- “There was high heterogeneity in the meta-analysis, unexplained by the subgroup analysis, indicating that the reasons for the variation remains unknown.” : les auteurs expliquent eux-mêmes avoir relevé des résultats très variables dans les études analysées, mais sans comprendre pourquoi.
- “Despite efforts to select outcomes that controlled for pre-specified confounders, restricting outcomes that controlled for these confounders only was not always possible. Consequently, there were differences between studies in terms of the characteristics that were controlled for.” : malgré leurs efforts pour sélectionner des résultats qui contrôlaient les facteurs confondants*, ce n’était pas toujours possible.
- “The data from included studies may also be subject to social desirability and other reporting biases due to the self-report nature of the data collection methods.” : les études incluses contenaient toutes des données auto-déclarées, limitant de fait leur fiabilité.
- “Our findings are similar, albeit slightly weaker, to those reported by Khouja et al, where a significant association between e-cigarette use among non-smokers and later tobacco smoking was found.” : les auteurs utilisent le terme « association », et non pas « causalité ».
Là où l’OMS s’est probablement reconnue dans cette étude, c’est que malgré ces limitations, les auteurs n’hésitent pas à conclure qu’il est « urgent que les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour encadrer la disponibilité et la commercialisation des produits de cigarette électronique, avec ou sans nicotine, auprès des enfants et des adolescents. » Une conclusion bien alarmiste malgré une reconnaissance des nombreuses limitations de leur étude.
*Que sont les facteurs confondants ?
Un facteur confondant pourrait être comparé à un faux coupable dans une enquête. Dans le cas présent, nous pourrions imager ça de la manière suivante : nous observons des adolescents qui vapotent, puis qui finissent par fumer. Il est donc très facile de conclure que le vapotage cause le tabagisme. Mais les choses sont-elles aussi simples ?
Imaginons deux adolescents : Léa et Pierre. Léa est rebelle, défie l’autorité et aime prendre des risques. Pierre, de son côté, est très sage, bon à l’école, et a des parents stricts.
Qui est le plus à risque d’essayer le vapotage ? Léa ! Et qui a le plus de risques d’essayer la cigarette par la suite ? Léa encore une fois !
Le problème est donc simple : et si Léa s’était mise à fumer, non pas à cause du vapotage, mais simplement parce que son côté rebelle l’a poussée vers les deux comportements ?
Dans le cas de cette étude, les facteurs confondants sont nombreux ! Il s’agit d’adolescents, leur personnalité entre donc en ligne de comptes. Leur environnement aussi : ont-ils des parents qui fument ? Est-ce que leurs amis fument ? Ces adolescents se sentent-ils bien psychologiquement ? Ont-ils des problèmes à la maison, se sentent-ils stressés ?
Autant de facteurs qui pourraient expliquer pourquoi des adolescents se mettent à fumer des cigarettes ! Ce n’est pas le vapotage qui a causé leur tabagisme, c’est tout un tas de facteurs dans leur environnement ! Et ces facteurs confondants ne peuvent pas toujours être contrôlés dans les études. Ce qui remet en cause, non seulement le résultat de l’étude citée par l’OMS, mais aussi ceux de toutes les études incluses à cette méta-analyse.
Et si l’OMS ouvrait enfin les yeux ?
Malgré un départ sur les chapeaux de roues, le paragraphe suivant se révèle surprenant.
Dans ses précédentes communications, l’Organisation mondiale de la santé, lorsqu’il s’agissait de parler des effets sur la santé du vapotage, n’y allait pas par quatre chemins. Par exemple, dans un communiqué de presse publié en 2023, qui appelait à une « action urgente » contre la cigarette électronique, l’organisme indiquait que « les substances toxiques que génèrent les cigarettes électroniques peuvent provoquer des cancers et augmenter le risque de problèmes cardiaques et pulmonaires. » Des alertes infondées puisque l’OMS n’hésitait pas, pour se justifier, à citer des études scientifiques dont la piètre qualité avait entraîné leur rétractation, et dont les conclusions différaient des (très) nombreux travaux ayant démontré que la toxicité du vapotage est très inférieure à celle du tabagisme4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dans le rapport récemment présenté à Dublin, elle se contente cette fois d’indiquer que « les cigarettes électroniques sont souvent présentées comme une alternative moins nocive aux cigarettes classiques ; cependant, à ce jour, il n’a pas été prouvé que leur commercialisation ait apporté un bénéfice net pour la santé publique. » Un changement de ton pour le moins radical. L’OMS serait-elle, enfin, en train d’ouvrir les yeux ?
Au sujet de la nocivité du vapotage, peut-être, mais concernant son efficacité pour arrêter de fumer, sûrement pas. Ainsi, dans ses recommandations, elle continue d’inviter les pays du monde à « protéger le public contre les allégations trompeuses ou mensongères, telles que les fausses déclarations sur la sécurité ou l’efficacité pour l’arrêt du tabac. » Peut-être faudra-t-il encore attendre cinq ans pour que l’organisme s’informe correctement à ce sujet.
Pour rappel, une méta-analyse11 réalisée par la prestigieuse organisation Cochrane, mondialement reconnue pour la qualité de son travail, a conclu que le vapotage a une efficacité deux fois supérieure pour arrêter de fumer, que les substituts nicotiniques traditionnels, comme les patchs ou les gommes à mâcher. Un résultat provenant de l’analyse de 90 études, qui ne semble toujours pas être arrivé aux oreilles de l’OMS. Combien de temps l’organisation pourra-t-elle encore ignorer les faits ?
Sources et références
1 WHO report on the global tobacco epidemic, 2025: warning about the dangers of tobacco. Télécharger le rapport
2 Drogues et addictions, chiffres clés – 2025 – OFDT. Télécharger le rapport français
3 Drogues et addictions, chiffres clés – 2025 – OFDT. Télécharger le rapport français
4 Holt, N. M., Shiffman, S., Black, R. A., Goldenson, N. I., Sembower, M. A., & Oldham, M. J. (2023). Comparison of biomarkers of exposure among US adult smokers, users of electronic nicotine delivery systems, dual users and nonusers, 2018–2019. Scientific Reports, 13, 7297. https://doi.org/10.1038/s41598-023-34427-x
5 Goniewicz, M. L., Gawron, M., Smith, D. M., Peng, M., Jacob, P., & Benowitz, N. L. (2017). Exposure to nicotine and selected toxicants in cigarette smokers who switched to electronic cigarettes: A longitudinal within-subjects observational study. Nicotine & Tobacco Research, 19(2), 160-167. https://doi.org/10.1093/ntr/ntw160
6 Shahab, L., Goniewicz, M. L., Blount, B. C., Brown, J., McNeill, A., Alwis, K. U., Feng, J., Wang, L., & West, R. (2017). Nicotine, carcinogen, and toxin exposure in long-term e-cigarette and nicotine replacement therapy users: A cross-sectional study. Annals of Internal Medicine, 166(6), 390-400. https://doi.org/10.7326/M16-1107
7 Nutt, D. J., Phillips, L. D., Balfour, D., Curran, H. V., Dockrell, M., Foulds, J., Fagerstrom, K., Letlape, K., Milton, A., Polosa, R., Ramsey, J., & Sweanor, D. (2014). Estimating the harms of nicotine-containing products using the MCDA approach. European Addiction Research, 20(5), 218-225. https://doi.org/10.1159/000360220
8 Stephens, W. E. (2018). Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke. Tobacco Control, 27(1), 10-17. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-053808
9 Polosa, R., Rodu, B., Caponnetto, P., Maglia, M., & Raciti, C. (2013). A fresh look at tobacco harm reduction: The case for the electronic cigarette. Harm Reduction Journal, 10, 19. https://doi.org/10.1186/1477-7517-10-19
10 Taylor, E., Simonavičius, E., McNeill, A., Brose, L. S., East, K., Marczylo, T., & Robson, D. (2024). Exposure to tobacco-specific nitrosamines among people who vape, smoke, or do neither: A systematic review and meta-analysis. Nicotine & Tobacco Research, 26(3), 257-269. https://doi.org/10.1093/ntr/ntad156
11 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub4.
Le reste de l’actualité