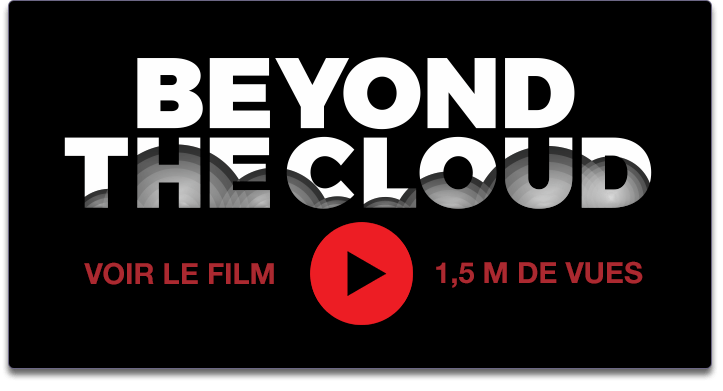La cigarette électronique en Suisse
La Suisse : Un retard persistant dans la lutte contre le tabagisme
Contrairement à de nombreux pays européens qui ont réussi à réduire significativement leur taux de tabagisme, la Suisse affiche des résultats mitigés dans sa lutte contre le tabac. En 2022, 23,9 % de la population suisse âgée de 15 ans et plus fumait, selon l’Enquête suisse sur la santé. Bien que ce chiffre marque une baisse notable par rapport à 2017 (27,1 %) et à 1997 (33,2 %), il reste préoccupant au regard des standards internationaux et des performances d’autres nations européennes.
Une évolution lente du taux de tabagisme
Le tabagisme en Suisse a connu une évolution contrastée au cours des dernières décennies. Si la proportion de fumeurs a diminué depuis les années 1990, cette baisse s’est révélée particulièrement lente comparée aux progrès réalisés dans d’autres pays. Entre 2017 et 2022, le pays a enregistré une diminution significative du tabagisme quotidien, passant de 19,1 % à 16,1 % de la population. La part des fumeurs occasionnels est quant à elle restée stable, autour de 8 %.
Cette évolution reste cependant insuffisante. Environ une personne sur six fume quotidiennement en Suisse, avec des disparités importantes selon le sexe : 27,1 % des hommes fumaient en 2022, contre 20,8 % des femmes. L’écart entre les genres tend toutefois à se réduire progressivement. Chez les hommes, la baisse du tabagisme est particulièrement marquée chez les 15-24 ans et les 65 ans et plus, tandis que l’on observe une augmentation chez les fumeuses de 65 ans et plus.
Des inégalités sociales marquées
Le tabagisme demeure un important marqueur social en Suisse. Le niveau de formation influence considérablement le taux de fumeurs : en 2022, 26,9 % des personnes dont la formation ne dépassait pas le secondaire II fumaient, contre seulement 20 % parmi celles possédant un diplôme du degré tertiaire. Cette différence s’explique par divers facteurs socio-économiques et culturels.
La situation professionnelle joue également un rôle déterminant. Les personnes sans emploi sont particulièrement touchées par le tabagisme, avec deux personnes sur cinq qui fument quotidiennement. Des différences existent aussi entre les régions linguistiques : en 2022, la Suisse italienne présentait le taux de fumeurs le plus élevé (26 %), devant la Suisse romande (24,3 %) et la Suisse alémanique (23,7 %). La population étrangère vivant en Suisse affiche par ailleurs un taux de tabagisme supérieur (28,2 %) à celui des citoyens suisses (22,5 %).
Un coût sanitaire et économique considérable
Les conséquences du tabagisme pèsent lourdement sur la santé publique suisse. Chaque année, le tabac cause environ 9 500 décès dans le pays, soit 26 personnes par jour et 14 % de l’ensemble des décès. Ces décès sont principalement dus à des maladies cardiovasculaires (34 %), au cancer du poumon (29 %), à des maladies des voies respiratoires (17 %) et à d’autres cancers (16 %). Un cinquième de ces décès concerne des personnes de moins de 65 ans.
Sur le plan économique, le tabagisme grève l’économie suisse de près de 3,9 milliards de francs chaque année, dont 3 milliards sont consacrés aux traitements médicaux et 0,9 milliard à la compensation des pertes de gains. Paradoxalement, la prévention du tabagisme s’avère particulièrement rentable : selon des chercheurs de l’Université de Neuchâtel et de la Haute école spécialisée de Zurich, chaque franc investi dans la prévention rapporte un bénéfice net de 41 francs à la société.
Une position isolée sur la scène internationale
La non-ratification de la Convention-cadre de l’OMS
La Suisse occupe une position unique et controversée sur la scène internationale en matière de lutte antitabac. Le pays a signé la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac le 25 juin 2004, manifestant ainsi sa volonté de mettre en œuvre les objectifs de prévention du tabagisme de l’Organisation mondiale de la Santé. Pourtant, vingt ans plus tard, la Suisse n’a toujours pas ratifié ce traité international.
Cette situation fait de la Suisse l’un des seuls pays d’Europe, avec Monaco et le Liechtenstein, à ne pas avoir ratifié la Convention-cadre. Sur les 53 pays de la région européenne de l’OMS, 51 l’ont ratifiée, permettant à 99,1 % de la population européenne de bénéficier de la protection offerte par ce traité. Les habitants de la Suisse font partie du 0,9 % restant, privés de cette protection internationale en matière de santé publique.
L’influence de l’industrie du tabac
Cette absence de ratification s’explique largement par le poids considérable de l’industrie du tabac en Suisse. Le pays héberge le siège de deux des trois plus grandes multinationales du tabac au monde : Philip Morris International et Japan Tobacco International, auxquelles s’ajoute British American Tobacco. Ces entreprises profitent d’une législation particulièrement favorable et exercent une influence notable sur les décisions politiques.
Les autorités fédérales ont longtemps justifié l’absence de ratification par le manque de dispositions d’exécution adéquates. Toutefois, un avis juridique de 2019 a démontré que les adaptations apportées par la nouvelle loi sur les produits du tabac permettent désormais à la Suisse de ratifier la Convention-cadre. Malgré cela, le Parlement a rejeté en février 2024 un projet d’interdiction de publicité visant à protéger les mineurs, témoignant de l’emprise persistante du lobby du tabac sur les décisions politiques.
Le cadre réglementaire suisse
Une législation en évolution
Consciente de son retard en matière de lutte antitabac, la Suisse a progressivement renforcé sa législation ces dernières années. En octobre 2021, le Parlement suisse a adopté la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, entrée en vigueur le 1er octobre 2024. Cette loi harmonise plusieurs mesures au niveau fédéral et marque un tournant dans la politique sanitaire du pays.
Depuis cette date, la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques aux mineurs de moins de 18 ans est interdite dans toute la Suisse. Auparavant, seize cantons appliquaient déjà cette limite d’âge à 18 ans, tandis que huit autres l’avaient fixée à 16 ans et deux cantons ne disposaient d’aucune limite. Cette harmonisation fédérale représente donc une avancée notable pour la protection de la jeunesse.
La protection contre le tabagisme passif
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, entrée en vigueur en 2010, interdit de fumer dans les lieux publics fermés. Cette mesure a produit des effets mesurables sur la santé publique. Le nombre de personnes exposées involontairement à la fumée du tabac au moins une heure par jour a chuté de 35 % en 2002 à 6 % en 2017.
Des études menées peu après l’instauration des premières interdictions cantonales ont mis en évidence un net recul de certaines maladies liées au tabagisme. L’Hôpital cantonal des Grisons a enregistré une baisse significative des admissions suite à un infarctus du myocarde. Au Tessin, ces cas ont diminué de 21 %, tandis qu’à Genève, les hospitalisations pour maladies pulmonaires chroniques ou pneumonie ont nettement reculé de 19 %.
Les limites de la politique antitabac
Malgré ces avancées, la politique suisse de lutte contre le tabagisme demeure insuffisante comparée aux standards internationaux. La publicité pour le tabac reste très présente en Suisse, notamment sur les points de vente, dans les discothèques et les festivals destinés à la jeunesse. Bien que l’interdiction de publicité dans l’espace public extérieur soit désormais en vigueur, la publicité reste autorisée dans la presse écrite, sur Internet et dans de nombreux autres espaces, dans la mesure où elle ne cible pas explicitement les mineurs.
En février 2022, l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac » a été acceptée par 56,6 % de la population suisse. Cette décision devrait entraîner une révision de la loi sur les produits du tabac, avec une entrée en vigueur prévue en 2026. Cette révision étendra considérablement le périmètre de la loi en interdisant toute publicité pour le tabac et les cigarettes électroniques dans la presse écrite et dans les lieux publics accessibles aux mineurs, y compris les points de vente et les festivals.
La cigarette électronique en Suisse
Un changement de statut réglementaire
Jusqu’en 2021, la cigarette électronique bénéficiait en Suisse d’un statut juridique particulier. Considérée comme un « objet usuel », elle relevait de la loi sur les denrées alimentaires et échappait ainsi à la législation sur les produits du tabac. Cette situation a radicalement changé avec l’adoption de la loi sur les produits du tabac en octobre 2021.
Depuis le 1er octobre 2024, les cigarettes électroniques sont assimilées aux produits du tabac et soumises à la même réglementation stricte. Ce changement de statut s’accompagne de limitations importantes en termes de vente, de publicité, d’étiquetage et d’utilisation des produits de vapotage. La Suisse s’aligne ainsi sur les directives européennes, bien qu’elle ne soit pas membre de l’Union européenne.
La réglementation des produits
La nouvelle législation impose des normes strictes pour les produits de vapotage commercialisés en Suisse. Les cigarettes électroniques jetables et les cartouches à usage unique sont limitées à un volume maximum de 2 millilitres par unité, avec une concentration maximale de 20 mg de nicotine par millilitre. Les flacons d’e-liquide contenant de la nicotine ne peuvent pas dépasser une contenance de 10 millilitres, tandis que les produits sans nicotine ne sont soumis à aucune limite de volume.
L’étiquetage des produits doit désormais inclure plusieurs informations obligatoires : la teneur en nicotine exprimée en milligrammes par millilitre, des mises en garde sanitaires sur les dangers pour la santé et le potentiel de dépendance, ainsi que la liste complète des ingrédients. Ces avertissements doivent couvrir au moins 35 % de la face la plus visible de l’emballage et être imprimés en caractères gras.
L’interdiction des cigarettes électroniques jetables
En juin 2025, le Parlement fédéral a adopté une mesure importante en interdisant la vente de cigarettes électroniques jetables (puffs) à usage unique. Cette décision vise à protéger la jeunesse, ces produits étant particulièrement populaires auprès des adolescents. Des mesures transitoires ont été mises en place pour permettre l’écoulement des stocks jusqu’à la fin de l’année 2025. Les modèles rechargeables, avec pods remplaçables ou réservoirs rechargeables, restent quant à eux autorisés.
La taxation des produits de vapotage
À partir d’octobre 2024, une nouvelle taxe sur les liquides contenant de la nicotine a été instaurée. Selon le produit, entre 0,20 et 1 franc suisse sont facturés par millilitre de liquide nicotiné. Cette taxation rend les produits de vapotage plus coûteux, bien qu’ils demeurent nettement moins onéreux que les cigarettes traditionnelles. Les e-liquides et cartouches sans nicotine ne sont pas soumis à cette taxe.
Les restrictions d’usage
Avec la nouvelle loi, la cigarette électronique tombe sous le coup de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Il est désormais impossible de vapoter dans tous les lieux publics fermés où le tabac est déjà proscrit, incluant les restaurants, bars, lieux de travail, transports publics et autres espaces clos accessibles au public. Une seule concession a été faite aux professionnels de la vape : l’usage de la cigarette électronique reste autorisé dans des zones déterminées des magasins de vente spécialisée, permettant ainsi aux commerçants de conseiller et accompagner leur clientèle.
Cette interdiction de vapoter dans les espaces publics fermés s’explique par la volonté des autorités de limiter l’exposition au vapotage passif. Toutefois, cette mesure fait l’objet de critiques de la part des défenseurs de la réduction des risques, qui soulignent que le vapotage passif présente un profil de risque bien inférieur au tabagisme passif.
La publicité et la protection de la jeunesse
La nouvelle législation interdit strictement la publicité pour les cigarettes électroniques dans l’espace public, lors de manifestations sportives, au cinéma et sur les sites Internet destinés aux mineurs. Toute publicité ciblant explicitement les mineurs est prohibée, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, notamment dans les salles de cinéma et lors de manifestations culturelles ou sportives. La vente par distributeurs automatiques de cigarettes électroniques est également interdite.
La vente en ligne de cigarettes électroniques et d’e-liquides nicotinés reste légale, mais doit respecter des obligations strictes : contrôle d’âge renforcé à l’achat avec vérification obligatoire de l’identité, et interdiction des pratiques promotionnelles visant les mineurs telles que les cadeaux, le parrainage ou les incitations visuelles.
La cigarette électronique comme outil de réduction des risques
Une adoption croissante mais modérée
En 2022, 3 % de la population suisse utilisait des cigarettes électroniques au moins une fois par mois. Cette prévalence grimpe à 5,7 % chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, témoignant d’un intérêt particulier de cette tranche d’âge pour ce dispositif. Chez les adolescents, la consommation de cigarettes électroniques a connu une progression notable : en 2022, 28 % des jeunes de 14 à 15 ans affirmaient avoir utilisé une cigarette électronique dans les 30 jours précédant l’enquête, sans différence significative entre les sexes.
Comme dans d’autres pays, les utilisateurs réguliers de cigarettes électroniques en Suisse sont essentiellement des fumeurs qui cherchent à réduire ou arrêter leur consommation de tabac. Cette observation conforte le rôle potentiel de la cigarette électronique comme outil de sevrage tabagique, même si elle n’est pas encore reconnue officiellement comme telle par les autorités sanitaires suisses.
Un débat sur la réduction des risques
La question de la cigarette électronique comme instrument de réduction des risques divise les acteurs de la santé publique en Suisse. Selon Jean-Felix Savary, secrétaire général du groupe romand d’étude des addictions, « avec le vapotage, on peut réduire de manière significative les dégâts qui sont causés par le tabac ». Plusieurs experts plaident pour une reconnaissance officielle de la cigarette électronique dans le cadre du sevrage tabagique, à l’image de ce qui se pratique au Royaume-Uni.
Toutefois, le fait d’assimiler réglementairement les cigarettes électroniques aux produits du tabac soulève des interrogations. Cette analogie ne tient pas compte des différences significatives en termes de profil de risque entre le vapotage et le tabagisme. Certains professionnels de santé estiment qu’une réglementation différente devrait être mise en place pour permettre à la cigarette électronique de jouer pleinement son rôle dans le sevrage tabagique.
Des disparités régionales
Une particularité intéressante du développement de la cigarette électronique en Suisse réside dans les disparités régionales. Entre 2011 et 2014, la prévalence tabagique a reculé en Suisse romande de 27 % à 25,9 %, alors qu’elle a augmenté en Suisse alémanique, passant de 23,6 % à 24,5 %. Dans le même temps, le développement de la vape s’est révélé plus rapide en Romandie qu’en Suisse allemande. Cette différence pourrait s’expliquer par des approches culturelles distinctes : la sphère francophone semble plus réceptive aux approches de réduction des risques, tandis que la sphère alémanique adopte une position plus conservatrice en matière de prévention.
Les perspectives d’avenir
Avec son statut de pays hébergeant plusieurs géants du tabac et sa réticence à ratifier la Convention-cadre de l’OMS, la Suisse se trouve à la croisée des chemins en matière de politique antitabac. Le durcissement récent de la législation marque certes une volonté de progresser, mais le pays reste en retard par rapport aux standards internationaux. La question de la reconnaissance de la cigarette électronique comme outil de réduction des risques demeure ouverte et pourrait jouer un rôle crucial dans l’évolution future de la politique de santé publique helvétique.
Face à un taux de tabagisme qui stagne depuis des années et à des coûts sanitaires considérables, la Suisse pourrait gagner à adopter une approche plus pragmatique de la réduction des risques. L’exemple de pays comme le Royaume-Uni ou la Suède, qui ont intégré les alternatives moins nocives dans leur stratégie de santé publique, montre qu’il est possible de réduire drastiquement les méfaits du tabac en encourageant la transition vers des produits à risque réduit.
Sources
- La prévalence du tabagisme dans la population générale – AT Schweiz
- Consommation de tabac – Observatoire valaisan de la santé
- Cigarettes & Co – Consommation – Addiction Suisse
- La Suisse compte de moins en moins de fumeurs – RTS
- Consommation de tabac (âge: 15+) – MonAM OFSP
- 20 ans d’immobilisme : l’attentisme fatal de la Suisse concernant la Convention sur le tabac – AT Schweiz
- La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac – Génération sans tabac
- Ratification de la Convention-cadre de l’OMS en Europe – OxySuisse
- Nouvelle réglementation sur les cigarettes électroniques – Sweetch
- Cigarette électronique: état de la législation en Suisse et dans le monde – RTS
- Suisse : nouvelles réglementations sur le tabac et les produits du vapotage à Vaud – Génération sans tabac