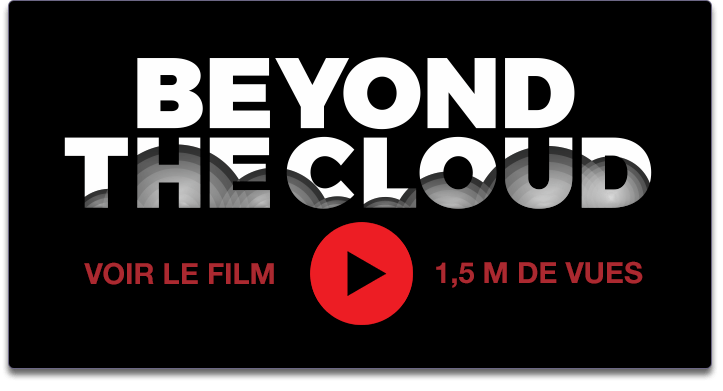Une nouvelle méta-analyse alerte sur un risque accru de BPCO chez les vapoteurs. Mais derrière cette annonce, de nombreux biais majeurs remettent sérieusement en cause la validité de ses conclusions.
Ce qu’il faut retenir
- Une nouvelle méta-analyse suggère un lien entre vapotage et bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), mais ses conclusions sont contestables ;
- La plupart des études reposent sur des auto-déclarations et ne tiennent pas compte du passé tabagique ;
- Cette recherche ne permet pas de conclure qu’il existe le moindre lien entre vapotage et BPCO.
Une association… mais que vaut-elle vraiment ?
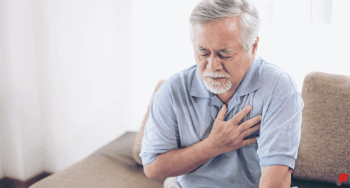
Dans leur recherche, les auteurs de cette méta-analyse ont inclus 17 études observationnelles. Ces dernières regroupaient un total de plus de 4,3 millions de participants adultes, dont la grande majorité résidait aux États-Unis. Sur ces 17 études, 15 provenaient des USA, une de Chine, et la dernière de Corée du Sud.
Après analyse des données de tous ces travaux, les auteurs ont souligné qu’il existait une association statistiquement significative entre l’usage du vaporisateur personnel et un risque accru de BPCO. « Ces résultats soulignent la nécessité pour les professionnels de la santé de surveiller la santé respiratoire des utilisateurs d’e-cigarettes, en particulier ceux qui souffrent de maladies préexistantes. De plus, les initiatives de santé publique sont essentielles pour sensibiliser aux dangers respiratoires de l’utilisation de la cigarette électronique et pour promouvoir des pratiques de consommation plus sûres (…) », ont-ils concluent.
Les (trop) nombreuses limites de cette analyse
Comme nous avons déjà pu l’observer lors de précédentes études alertant sur les dangers du vapotage, celle-ci ne déroge pas à ce qui semble désormais être une habitude pour certains chercheurs : l’alarmisme des conclusions ne tient pas compte des nombreuses limites de l’étude en question.
Si la méthodologie de ce travail est robuste, notamment grâce à l’utilisation de différents outils destinés à la réduction du biais de publication, la recherche d’études à travers trois bases de données majeures, ou encore plusieurs analyses de sensibilité multiples pour tester la robustesse de la méta-analyse, de sérieuses limites doivent être soulignées, dont certaines remettent directement en question ses résultats.
Le problème des données autodéclarées
Pour commencer, il convient de souligner que sur les 17 études incluses, 15 se basaient sur l’auto-déclaration pour les participants souffrant de BPCO. Autrement dit, aucun examen clinique n’a confirmé que les participants souffraient effectivement d’une bronchopneumopathie chronique obstructive. D’ailleurs, lorsque les auteurs ont refait les calculs, cette fois en ne tenant compte que des participants qui avaient été médicalement diagnostiqués, les statistiques devenaient non-significatives.
L’utilisation d’études transversales
Ensuite, sur les 17 études analysées, 12 étaient transversales. Ce type d’étude présente un problème majeur, celui de la temporalité des événements, dont il ne tient pas compte. Voici un exemple pour bien comprendre de quoi il s’agit :
- 2015 : un fumeur de longue date commence à ressentir un essoufflement dont il ne souffrait pas avant ;
- 2018 : ayant entendu dire que le vapotage était moins nocif que le tabagisme, il fait le choix d’arrêter de fumer et de remplacer son tabagisme par l’utilisation d’une cigarette électronique ;
- 2020 : une BPCO est diagnostiquée chez cet ancien fumeur, devenu vapoteur, et cette même année, il est inclus dans une étude transversale qui observe : ce fumeur souffre d’une BPCO et il vapote. L’association est donc faite entre le vapotage et cette maladie. Sans que son passé tabagique ne soit pris en compte, puisqu’une étude transversale ne s’intéresse qu’à une situation à un moment précis. Dans cet exemple, la situation en 2020 : cette personne souffre d’une BPCO et elle vapote.
C’est pour cette raison que les études transversales ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une recherche de causalité. Lorsqu’on souhaite prouver qu’une condition A cause une situation B, le premier critère à prendre en compte est forcément que la condition A s’est produite avant la situation B. Hors, les études transversales ne tiennent pas compte de la temporalité des événements. Il est donc impossible de les utiliser dans le cadre d’une recherche de causalité.
C’est d’ailleurs ce qu’établissent les critères de Bradford Hill, universellement reconnus en épidémiologie depuis 1965 : « la temporalité est considérée comme fondamentale à la causalité ; une exposition doit précéder un résultat. »4 Une règle confirmée par des sources académiques de référence5, qui stipulent que « puisque la temporalité de l’association est un critère fort pour la causalité, les études transversales ne peuvent pas prouver la causalité. »
Les facteurs confondants ignorés
La limite suivante concerne, comme souvent, les facteurs confondants. Ces facteurs sont une variable qui influencent à la fois l’exposition et l’effet étudié. Reprenons un exemple imagé pour bien comprendre :
Une étude observe que les gens qui mangent de la glace ont plus d’accidents de vélo. Mais est-ce vraiment le fait de manger de la glace qui fait que l’on a un accident de vélo ? Non, dans cet exemple, le facteur confondant est la chaleur !
Lorsqu’il fait chaud, les gens mangent plus de glaces. Lorsqu’il fait chaud, les gens font plus de vélo. Et s’il y a plus de vélos, il y a plus d’accidents. Résultat, on observe que le fait de manger de la glace fait augmenter le nombre d’accidents de vélo, mais en réalité, c’est la chaleur qui cause les deux !
Dans la méta-analyse dont nous parlons dans cet article, le principal facteur confondant pourrait être, bien sûr, le tabagisme !
L’étude observe que les vapoteurs souffrent plus souvent d’une BPCO. Pourtant, si l’on considère que le tabagisme pourrait être un facteur confondant, les résultats changent drastiquement :
Un participant fume pendant 20 ans, il commence à souffrir de différents problèmes de santé et décide de passer au vapotage. Quelques années plus tard, on lui diagnostique une bronchopneumopathie chronique obstructive. Un jour, ses données sont utilisées pour une étude qui voit : ce participant souffre d’une BPCO et il vapote. Elle conclut donc que la vape est à l’origine de sa BPCO.
Mais la vérité est en fait bien différente. Le tabagisme a créé des problèmes de santé chez ce fumeur, qui a donc décidé de passer au vapotage. Parce qu’il a fumé pendant 20 ans, il a développé des problèmes de santé. Le tabagisme est donc le facteur confondant : c’est lui qui a causé ses problèmes de santé, et c’est lui qui l’a poussé à vapoter. L’usage d’une cigarette électronique n’est absolument pas lié à ses problèmes.
Et puisque dans la plupart des études incluses à cette méta-analyse, les antécédents tabagiques étaient souvent mal documentés, il est tout simplement impossible de savoir s’ils ont causé les maladies dont souffrent les participants. Ce qui n’empêche pas les auteurs de sous-entendre dans leurs conclusions que le vapotage en serait la cause. Sans parler du fait que si le tabagisme fait partie des principaux facteurs de BPCO, d’autres existent, comme la pollution de l’air, notamment dans l’environnement professionnel. Facteur qui n’a, là encore, pas été pris en compte.
Des conclusions bien trop hâtives
Et il n’y avait même pas besoin d’aller jusque là pour remettre en cause les résultats de cette méta-analyse. Ses auteurs auraient dû être alertées, dès le départ, après avoir observé que les résultats n’étaient plus significatifs en retirant les diagnostics auto-déclarés, qu’il y avait visiblement un problème avec les données utilisées.
En science, corrélation ne vaut pas causalité. Tant que les études n’isoleront pas clairement le vapotage exclusif de tout antécédent tabagique, toute conclusion alarmiste sur la vape et la BPCO restera à prendre avec de grandes pincettes.
Sources et références
1 Shabil, M., Malvi, A., Khatib, M.N. et al. Association of electronic cigarette use and risk of COPD: a systematic review and meta-analysis. npj Prim. Care Respir. Med. 35, 31 (2025). https://doi.org/10.1038/s41533-025-00438-6
2 Forey, B. A., Thornton, A. J., & Lee, P. N. (2011). Systematic review with meta-analysis of the epidemiological evidence relating smoking to COPD, chronic bronchitis and emphysema. BMC Pulmonary Medicine, 11, 36. https://doi.org/10.1186/1471-2466-11-36
3 Park, J., Kim, H. J., Lee, C. H., Lee, C. H., & Lee, H. W. (2021). Impact of long-term exposure to ambient air pollution on the incidence of chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. Environmental Research, 194, 110703. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110703
4 Lash, T. L., VanderWeele, T. J., Haneuse, S., & Rothman, K. J. (2021). Assessing causality in epidemiology: revisiting Bradford Hill to incorporate developments in causal thinking. European Journal of Epidemiology, 36(5), 447-462. https://doi.org/10.1007/s10654-020-00703-7
5 ScienceDirect Topics. Cross Sectional Study. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cross-sectional-study
Les dernières études sur la cigarette électronique